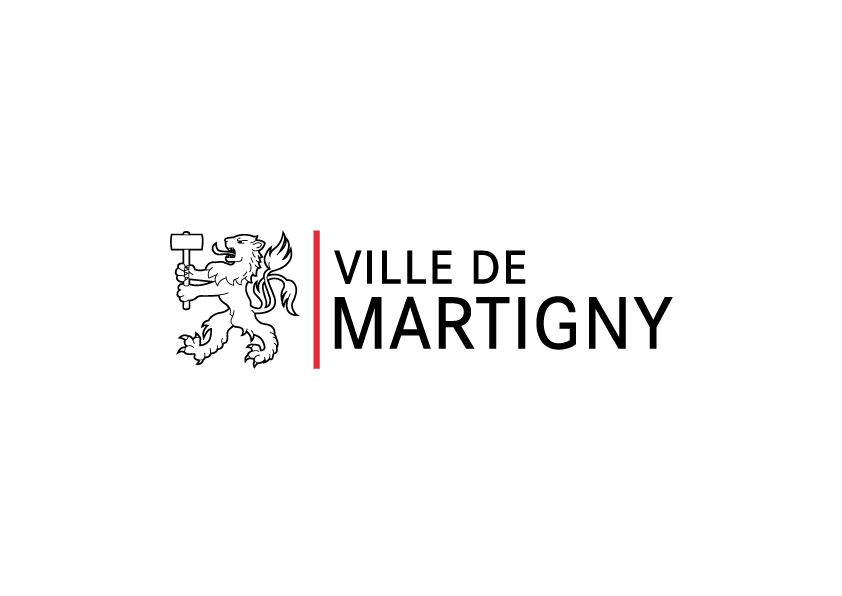La Foire au Lard de Marigny-Bourg est un événement emblématique qui enchante les habitants et les visiteurs chaque année. Nichée au cœur d’un quartier pittoresque, cette foire est un véritable hommage à la tradition et à la gastronomie locale.
Dès les premières lueurs de l’aube, les ruelles se remplissent d’une effervescence joyeuse. Les étals colorés du marché débordent de produits du terroir, mettant en avant la richesse de notre patrimoine culinaire. Le cochon, bien sûr, est à l’honneur, fumé, salé, ou en saucisses, chaque déclinaison est une promesse de saveurs authentiques.
Mais la Foire au Lard, ce n’est pas seulement une ode à la charcuterie. C’est aussi l’occasion de célébrer la convivialité, avec des animations musicales, des danses traditionnelles, et des jeux pour petits et grands. Les habitants se rassemblent pour partager des moments de joie et renforcer les liens qui font la force de la communauté de martigny.
Chaque année, la Grange à Émile, un bâtiment rustique empreint de charme, se métamorphose en un musée éphémère. La Foire au Lard sert ainsi de coup d’envoi à une exposition permanente.